
La capacité des multicoques de course à voler n’est pas magique, c’est le résultat d’un équilibre précaire entre une puissance hydrodynamique immense et la maîtrise humaine.
- Les foils agissent comme des ailes d’avion sous-marines, soulevant les coques hors de l’eau pour annuler la traînée hydrodynamique.
- Cette vitesse extrême engendre des risques uniques, où la frontière entre le record et le chavirage est constamment gérée par le skipper.
Recommandation : Pour vraiment comprendre ces machines, il faut voir au-delà de la technologie et apprécier le dialogue constant et périlleux entre le pilote et son voilier.
L’image est saisissante, presque irréelle. Un géant de carbone de 32 mètres, pesant plusieurs tonnes, qui s’élève au-dessus des vagues, ne touchant l’eau qu’à la pointe de trois appendices effilés. On parle souvent de « voiliers qui volent », une formule qui capture le spectacle mais occulte l’essentiel. Beaucoup pensent que c’est une simple question de technologie, une sorte de magie permise par des « ailes » sous-marines. La réalité, celle que l’on ressent aux commandes, est bien plus complexe et viscérale. Ce n’est pas le bateau qui décide de voler ; c’est un dialogue constant, une tension permanente entre la machine et son pilote.
Loin d’être un automatisme, ce vol est un état instable, un équilibre précaire que le skipper doit conquérir à chaque seconde. La véritable révolution n’est pas seulement dans le carbone ou la forme des foils. Elle réside dans la capacité de l’homme à sentir, anticiper et dompter la puissance phénoménale de ces machines pour la transformer en vitesse pure. Oubliez la navigation traditionnelle ; ici, on pilote. On ne subit pas les éléments, on joue avec eux, en acceptant une part de risque immense où la moindre erreur de jugement peut être fatale. C’est l’histoire de cette maîtrise que nous allons explorer.
Cet article vous plonge au cœur du réacteur. Nous décortiquerons la science des foils, nous sentirons le danger inhérent à la très haute vitesse, nous partagerons la vie à bord de ces F1 des mers, et nous retracerons l’épopée technologique qui a mené à cette incroyable évolution. Préparez-vous à comprendre pourquoi ces bateaux ne font pas que naviguer : ils dansent à la limite de la physique.
Sommaire : La physique et l’audace derrière les géants des mers volants
- Les foils, ou l’art de transformer un bateau en avion de mer
- La vitesse a un prix : les dangers spécifiques de la navigation sur multicoque
- Le « confort » à 40 nœuds : la vie à bord des géants des mers
- Catamaran ou trimaran de course : deux coques, deux philosophies de la vitesse
- Des flotteurs en bois aux foils en carbone : 40 ans d’innovations qui ont réinventé la voile
- Ces yachts de luxe qui vont plus vite que des voiliers de course
- Votre quille, cet aileron sous-marin qui vous empêche de déraper
- Faites corps avec votre voilier en maîtrisant les secrets de l’hydrodynamisme
Les foils, ou l’art de transformer un bateau en avion de mer
L’idée de faire voler un bateau n’est pas nouvelle, mais sa concrétisation à grande échelle est une véritable révolution. Le secret réside dans le foil, un profilé hydrodynamique qui fonctionne exactement comme une aile d’avion, mais dans l’eau. En accélérant, le flux d’eau sur le profil courbe (l’extrados) est plus rapide que sur le profil plat (l’intrados). Cette différence de vitesse crée une dépression sur le dessus et une surpression en dessous, générant une force verticale : la portance. Quand cette portance devient supérieure au poids du bateau, il décolle.
Le gain est colossal. Une fois en l’air, la traînée hydrodynamique, qui freine la coque dans l’eau, disparaît quasi totalement. Le bateau n’est plus freiné que par la traînée aérodynamique et la friction minime des foils eux-mêmes. La vitesse peut alors exploser, passant de 20 à plus de 40 nœuds (près de 80 km/h) en quelques secondes. C’est un changement de dimension, une transition violente où le bateau passe d’un état archimédien à un état aérien. Des cabinets d’architecture navale français, comme VPLP, sont à la pointe de cette recherche. L’expérience acquise est immense, comme en témoignent les 40 ans d’innovations et plus de 6000 catamarans construits par le cabinet, une expertise qui façonne aujourd’hui l’avenir du transport maritime.
Cette technologie ne se limite plus à la course. Elle ouvre des perspectives pour le transport de passagers ou de marchandises, avec des projets visant à utiliser cette efficacité pour une navigation décarbonée. L’idée est de passer d’une consommation d’énergie brute à une gestion fine des flux, une philosophie qui dépasse largement le cadre de la compétition.
La vitesse a un prix : les dangers spécifiques de la navigation sur multicoque
Voler à 40 nœuds sur l’eau n’a rien d’une promenade de santé. À cette vitesse, l’eau devient dure comme du béton. Le moindre choc avec un OFNI (Objet Flottant Non Identifié) ou une vague mal négociée peut avoir des conséquences structurelles catastrophiques. Le danger le plus redouté sur ces machines reste le chavirage. Contrairement à un monocoque lesté qui se redressera, un multicoque qui se retourne reste à l’envers. Sur un trimaran, le risque principal est « l’enfournement » : le flotteur sous le vent plante dans une vague, provoquant un arrêt brutal et une culbute par l’avant, appelée « soleil ».

La gestion de la puissance est donc la clé de la sécurité. Le skipper doit en permanence « choquer » (relâcher les voiles) pour décharger la puissance dans les rafales, jouant sur un fil entre la performance maximale et la perte de contrôle. La course inaugurale de l’Arkéa Ultim Challenge en 2024, premier tour du monde en solitaire à bord de ces géants, a mis en lumière cet engagement total. Des marins d’exception comme Charles Caudrelier, Thomas Coville ou Armel Le Cléac’h ont dû repousser leurs limites pour boucler un parcours de 40 000 kilomètres, seuls face à la démesure de leurs machines et des océans.
L’autre danger, plus insidieux, est la déconnexion sensorielle. Protégé dans une cellule de vie fermée pour se préserver des embruns violents, le skipper peut perdre le contact direct avec les éléments. Il se fie alors aux chiffres des capteurs et au son du bateau, ce sifflement strident des appendices qui est le véritable baromètre de la santé du vol. Apprendre à interpréter cette symphonie de carbone et d’eau est une question de survie.
Le « confort » à 40 nœuds : la vie à bord des géants des mers
Le mot « confort » doit être utilisé avec d’infinies guillemets. La vie à bord d’un multicoque de course est une épreuve d’endurance physique et mentale. Le premier élément est le bruit. Un vacarme assourdissant et permanent, mélange du sifflement strident des foils, du martèlement des vagues contre les coques en carbone, et du hurlement du vent dans le gréement. Le sommeil se prend par tranches de 20 à 40 minutes, le corps calé dans un pouf pour amortir les chocs violents et imprévisibles.
L’humidité est omniprésente. Malgré les cockpits fermés, l’eau s’infiltre partout. L’espace de vie est réduit au strict minimum : une bannette, un petit réchaud pour la nourriture lyophilisée et la station de navigation. Chaque gramme est compté, donc le superflu n’a pas sa place. La dépense énergétique est considérable, non seulement à cause des manœuvres, mais aussi à cause du stress et de la concentration de tous les instants. Le skipper est un athlète de haut niveau qui doit gérer son effort sur la durée, parfois pendant plus de 40 jours.
Mais au-delà de la rudesse, il y a une concentration et une connexion à la machine qui sont totales. C’est un état de « flow » permanent, une immersion où chaque sens est en alerte. Comme le confiait le skipper Anthony Marchand avant le départ de l’Ultim Challenge, l’enjeu est de transformer la tension en performance :
Forcément, il y a de l’émotion, mais il va falloir vite basculer en mode régatier au moment du top départ.
– Anthony Marchand, France 24 – Départ Ultim Challenge
Cette bascule mentale est le cœur de la vie à bord : accepter l’inconfort et le danger pour se focaliser uniquement sur la trajectoire et la vitesse. C’est un exercice d’une exigence absolue, réservé à une élite de marins.
Catamaran ou trimaran de course : deux coques, deux philosophies de la vitesse
Si tous les multicoques de course cherchent la vitesse, catamarans et trimarans n’y parviennent pas de la même manière. Le choix entre deux ou trois coques dépend du programme de navigation, de la taille et de la recherche d’un équilibre spécifique entre puissance, stabilité et légèreté. Le trimaran, avec sa coque centrale et ses deux flotteurs latéraux, est le roi de la course au large en solitaire. Sa configuration lui offre une grande stabilité de plateforme et une puissance considérable. C’est l’architecture reine des classes Ultim et Ocean Fifty, conçues pour affronter les mers les plus formées du globe.
Le catamaran, avec ses deux coques identiques, est souvent privilégié pour les courses en équipage sur des parcours plus courts (in-shore), comme sur le circuit SailGP. Plus léger à taille égale, il est extrêmement réactif et agile. Cependant, sa stabilité transversale est plus délicate à gérer, et sa plage d’utilisation optimale est parfois plus étroite que celle d’un trimaran. Chaque classe de multicoques possède ses propres spécificités, ses « jauges » qui définissent des règles de conception strictes. Ces projets représentent des investissements colossaux, avec un coût de construction pouvant atteindre entre 15 et 18 millions d’euros pour un Ultim, justifiant une recherche technologique de pointe.
Le tableau suivant, basé sur une analyse des différentes classes, résume les principales catégories de multicoques de course que l’on peut voir sur les côtes françaises et autour du monde.
| Classe | Taille | Type | Skippers célèbres |
|---|---|---|---|
| Ultim | 23-32m | Trimaran | Gabart, Coville, Le Cléac’h |
| Ocean Fifty | 15m | Trimaran | Tripon, Leroux, Roucayrol |
| MOD 70 | 21m | Trimaran | Gavignet, Dick |
Au final, le choix entre deux ou trois coques n’est pas une question de supériorité absolue, mais d’optimisation pour un programme donné. Le trimaran pour la puissance et la polyvalence au large, le catamaran pour la légèreté et la réactivité sur des parcours balisés.
Des flotteurs en bois aux foils en carbone : 40 ans d’innovations qui ont réinventé la voile
La révolution des foils n’est pas née de nulle part. C’est l’aboutissement de décennies de recherches et d’audace, portées par des marins visionnaires. En France, la figure tutélaire est sans conteste Éric Tabarly. Dès 1980, son trimaran en aluminium *Paul Ricard*, équipé de plans porteurs, pulvérise le record de la traversée de l’Atlantique et met en lumière le potentiel des multicoques. Il a ouvert la voie, prouvant que l’on pouvait aller radicalement plus vite en s’appuyant sur plusieurs coques.
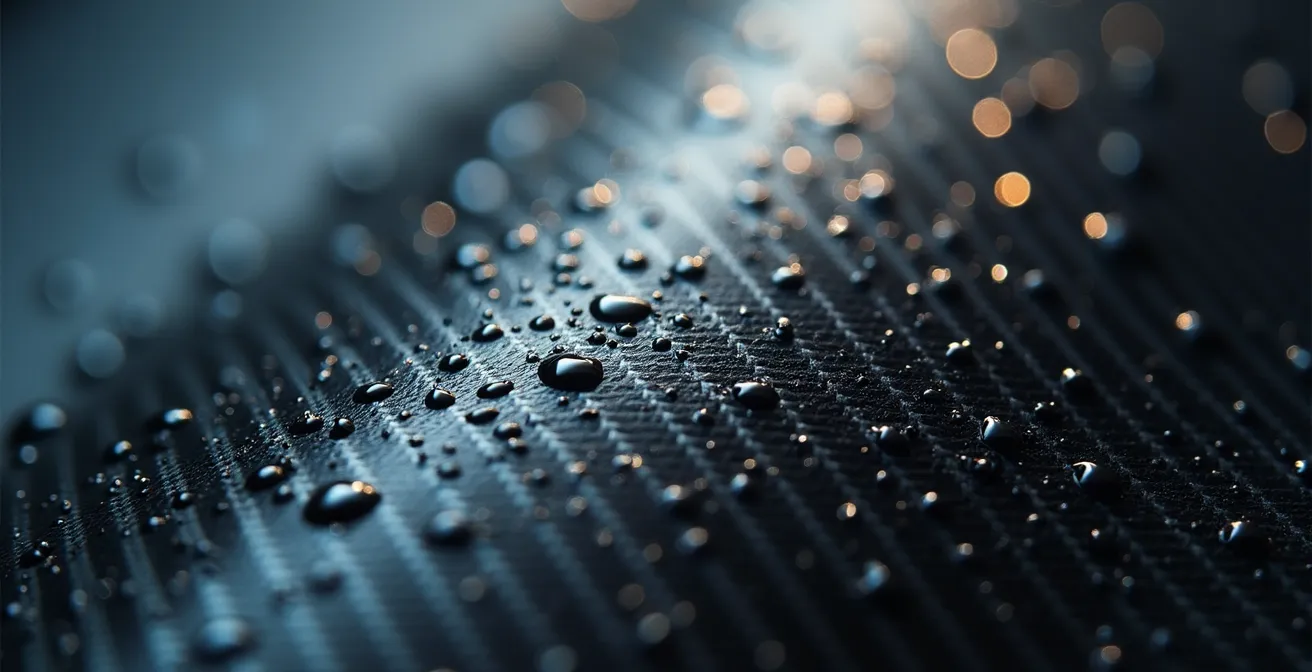
Dans son sillage, d’autres pionniers ont poursuivi l’expérimentation. Une étude de cas sur l’histoire des foils rappelle le rôle crucial d’Alain Thébault qui, avec l’Hydroptère, a consacré sa vie à faire voler un bateau. Son abnégation a payé : en 2009, il est le premier à franchir la barre mythique des 50 nœuds à la voile. Parallèlement, l’évolution des matériaux a été déterminante. Le passage du bois à l’aluminium, puis au composite de fibre de verre et enfin à la fibre de carbone a permis de construire des structures à la fois extrêmement légères et incroyablement rigides, capables de supporter les contraintes phénoménales du vol à haute vitesse.
Aujourd’hui, cette quête de vitesse atteint des sommets. Le record absolu de vitesse à la voile est détenu par un engin qui ressemble plus à une fusée qu’à un voilier. Il illustre la quintessence de la physique du foil, avec une pointe à 121 km/h (65,45 nœuds), établi par le Vestas Sailrocket 2. Chaque nouveau record, chaque nouvelle course, est une occasion de tester des formes de foils, des systèmes de régulation et des matériaux innovants qui, un jour, se retrouveront peut-être sur des voiliers plus accessibles.
Ces yachts de luxe qui vont plus vite que des voiliers de course
La technologie développée pour la course au large, où les budgets et les exigences de performance sont extrêmes, ne reste pas confinée aux circuits de compétition. Elle infuse progressivement dans le monde de la grande plaisance et du yachting de luxe. Les catamarans de croisière performants, souvent appelés « fast cruisers », bénéficient directement de ces avancées. Des marques prestigieuses comme Gunboat collaborent avec des architectes de course pour créer des yachts qui allient confort luxueux et vitesses impressionnantes, dépassant parfois celles de voiliers de course d’ancienne génération.
Le principal transfert de technologie concerne trois domaines :
- Les matériaux : L’utilisation généralisée du carbone et des composites permet d’alléger considérablement le poids des grands catamarans de luxe, améliorant leurs performances et leur réactivité.
- Le design des carènes : Les formes de coques fines et élancées, optimisées en course pour minimiser la traînée, sont reprises pour offrir une meilleure glisse et un passage en mer plus doux.
- Les appendices : Si les foils de sustentation totale sont encore rares en croisière, l’usage de dérives courbes ou de « foils d’assistance » se répand. Ces appendices ne soulèvent pas entièrement le bateau mais créent une portance qui l’allège, réduisant la gîte et améliorant le confort et la vitesse.
Cette fertilisation croisée est une stratégie consciente des grands acteurs du secteur. Comme l’explique le cabinet VPLP, pionnier dans la course comme dans la plaisance : « Le transfert permanent de nos savoir-faire d’un pôle à l’autre est la clé de notre capacité à innover ». L’audace d’un trimaran de course inspire la conception d’un catamaran familial, et la rigueur d’un projet de yachting de luxe apporte des solutions qui peuvent être adaptées à la course. C’est un cercle vertueux qui tire toute l’industrie nautique vers le haut.
Votre quille, cet aileron sous-marin qui vous empêche de déraper
Sur un voilier monocoque classique, la quille a un double rôle : son poids assure la stabilité (le couple de redressement) et sa surface latérale empêche le bateau de déraper sous la poussée du vent. Sur un multicoque, dépourvu de quille lestée, cette fonction anti-dérive est assurée par des appendices mobiles : les dérives. Et c’est précisément en travaillant sur ces dérives que les architectes ont ouvert la porte au vol. L’idée n’était plus seulement de s’opposer à la dérive, mais de générer une force utile.
L’une des étapes clés de cette évolution a été l’introduction des dérives courbes. Une étude de cas sur les innovations de VPLP pour le Vendée Globe raconte cette genèse. Comme l’expliquent les architectes à propos du monocoque IMOCA *Safran*, les premiers pas vers le vol ont été faits bien avant les foils en L que l’on connaît aujourd’hui. L’idée était d’expérimenter des dérives asymétriques pour générer une force de portance.
L’expérimentation sur Safran : les premiers pas vers le vol
Selon une analyse des innovations historiques de VPLP, sur le projet Safran, les architectes ont commencé à tester des dérives en forme de C pour générer de la portance lorsque le bateau gîtait. Le but n’était pas de voler, mais « d’alléger » le bateau pour diminuer sa traînée. C’était, en quelque sorte, les prémices des foils. Cette force verticale, au départ un simple « bonus », est devenue progressivement l’objectif principal du design des appendices.
De la dérive droite anti-dérive, on est passé à la dérive courbe qui soulage, puis au foil en « L » ou en « T » qui sustente. La fonction originelle n’a pas disparu, mais elle a été augmentée d’une nouvelle dimension verticale. La dérive n’est plus un simple aileron ; c’est devenu une aile, un moteur de performance à part entière.
À retenir
- Le vol des multicoques n’est pas magique, il repose sur la portance hydrodynamique créée par les foils, qui annule la traînée de la coque.
- La vitesse extrême (plus de 40 nœuds) engendre des dangers spécifiques comme le chavirage et impose une gestion humaine constante de la puissance.
- Les innovations de la course au large, notamment en matériaux (carbone) et en design d’appendices, se diffusent vers les yachts de luxe, améliorant leurs performances.
Faites corps avec votre voilier en maîtrisant les secrets de l’hydrodynamisme
Maîtriser l’hydrodynamisme d’un multicoque volant, c’est finalement apprendre à « sentir » le bateau. Au-delà des instruments, le pilote doit développer une conscience aigüe de la machine. Il écoute les sifflements, ressent les vibrations, anticipe la réaction du bateau à la moindre risée ou au plus petit clapot. C’est un dialogue subtil où l’homme devient le prolongement du bateau, et inversement. Il ne s’agit plus de barrer, mais de piloter en trois dimensions : gérer la trajectoire, la vitesse, et l’altitude de vol.
Cette maîtrise est un art complexe qui repose sur des ajustements permanents. Le vol stable est un mythe ; c’est une succession de déséquilibres maîtrisés. Comme le souligne l’architecte naval Quentin Lucet, même avec la meilleure technologie, le facteur humain reste la clé et la limite. En analysant les courses, il note que « les skippers solitaires n’ont pas été capables d’exploiter tout le potentiel de vitesse de leurs bateaux dans des conditions, notamment des états de mer, qu’ils n’avaient pas rencontrés lors des traversées transatlantiques ». Cela prouve que la machine, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut donner son plein potentiel que si le pilote a l’expérience et l’audace de la pousser dans ses retranchements.
Votre plan d’action pour comprendre le pilotage d’un multicoque volant
- Comprendre le principe de portance : Visualiser le foil comme une aile d’avion sous l’eau, où la vitesse génère une force vers le haut.
- Maîtriser le ‘rake’ : Intégrer que l’angle d’incidence du foil (son inclinaison avant/arrière) est le principal levier pour gérer l’altitude de vol.
- Ajuster le ‘cant’ : Saisir que l’angle latéral du foil permet de moduler la portance et de contrôler la stabilité transversale.
- Surveiller la vitesse de décollage : Savoir qu’il existe un seuil de vitesse (souvent entre 12 et 15 nœuds) en dessous duquel le bateau ne peut pas voler.
- Anticiper les décrochages : Être conscient qu’une baisse soudaine de vitesse ou une mauvaise incidence peut faire « décrocher » le foil, entraînant une chute brutale et dangereuse.
Faire corps avec son voilier, c’est donc accepter cette part d’instinct et de ressenti, tout en s’appuyant sur une compréhension fine des forces physiques en jeu. C’est cet alliage entre l’art et la science qui fait la beauté et la complexité de la voile moderne.
Le monde des multicoques de course est un laboratoire permanent qui repousse les frontières du possible. Pour transformer ces connaissances en performance, l’étape suivante consiste à analyser en détail les polaires de vitesse et les données de navigation afin d’optimiser chaque décision sur l’eau.